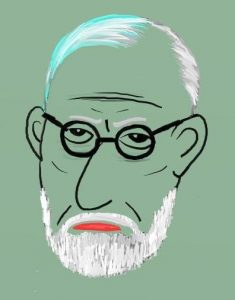La présence à soi et à l’autre : l’antidote à un monde qui tourne fou
La « présence » est un ingrédient essentiel au coaching. Elle est aussi un élément indispensable dans la vie de tous les jours, pour vivre, partager, entrer en relation, aller à la rencontre de l’autre, en profondeur. Dans ce monde qui tourne fou, elle permet aussi de dépasser les traumatismes et de ne pas perdre la tête.
Pour les coachs professionnels, la Présence représente le Graal. Sans une présence intense du coach, pas de coaching réellement puissant. C’est là, sans doute, l’ingrédient indispensable: bien plus que tous les outils (tirés de l’Analyse Transactionnelle, de la Programmation neuro-linguistique, des théories managériales, etc.), qui sont certes très utiles, mais totalement insatisfaisants s’ils ne sont pas soutenus par une présence « transcendante » du coach.
Et cette présence, elle est souvent mise à mal par le désir (légitime) de performance du coach.
Oui, le désir de performance est l’ennemi numéro Un de la présence. J’en sais personnellement quelque chose : jeune (en expérience, pas en âge 😉 ) coach, je me cramponnais à mes outils comme un naufragé à sa bouée. Je voulais donner à mon coaché le meilleur de moi-même, lui faire profiter des outils les plus indiqués, bref, je voulais être efficace, pour le bien de mon/ma client/e. Cela ne fonctionnait pas trop mal, mes clients se disaient pour la plupart satisfaits, et repartaient avec des pistes d’action.
Et puis, un jour, la catastrophe se produisit. Un imprévu dans mon emploi du temps m’avait empêchée de préparer minutieusement une séance de coaching en entreprise. Ce jour-là, je me suis rendue à mon rendez-vous en me reprochant mon impardonnable amateurisme, ma distraction fatale. Ce jour-là, je savais que je ne serais pas parfaite. Et cela me traumatisait. Evelyne (prénom d’emprunt), cadre dans cette entreprise, en souffrance, en stress, méritait mieux que mon impréparation.
Et puis ce jour-là, le miracle se produisit.
Lâcher prise pour aller à la rencontre de l’Autre
J’avais accepté, à ce moment, que mon coaching ne serait peut-être pas « efficace ». Je n’avais pas d’attente de performance. Je n’étais pas dans la volonté de bien faire. J’avais, heureusement, suffisamment de sécurité intérieure pour accepter cette situation. Je me disais que « ce coaching ne serait sans doute pas le meilleur de ma carrière, mais qu’importe, il y aura d’autres séances ».
Et le miracle se produisit.

En acceptant de marcher dans l’obscurité, j’ai pu laisser émerger l’Autre dans toute son intensité. En abandonnant mon ego, paradoxalement, j’ai été réellement, profondément, entièrement, présente à l’Autre dans sa vérité. En n’ayant aucune volonté, j’ai pu laisser être ce qui était là, à ce moment, pour l’Autre.
Je me suis mise à la disposition de l’Autre, sans m’imposer dans le champ. Et là, j’ai fait connaissance avec mon intuition, avec mon essentiel, avec ma justesse. Je me suis autorisée à prendre des risques. Mes paroles ont été puissantes. Je me suis sentie inspirante, élégante. Je me suis sentie géante, avec la finesse d’une fée.
Nous avons, ma coachée et moi-même, célébré cette séance d’une grande intensité.
Curieusement, je me sentais énergisée. Beaucoup moins fatiguée qu’à l’issue de mes autres séances de coaching savamment préparées.
Je n’avais (presque) rien fait et, en ne faisant rien, en laissant Evelyne découvrir à tâtons ses propres ressources, je lui avais permis de trouver son chemin.
J’étais consciente, dès cet instant, que ma pratique du coaching ne serait plus jamais la même. Jusque-là, j’étais une poule aux oeufs d’or pour les écoles de coaching: j’écumais toutes les formations, je n’en avais jamais assez. A partir de ce moment-là, je me suis montrée beaucoup plus parcimonieuse…
J’avais innové en me contentant d’être à l’écoute de l’Autre et de moi-même. Et innover, comme le dit si justement Michel-Ange, c’est simplement libérer la main du marbre qui la tenait prisonnière ».

Etre présent à soi pour garder le cap
Imaginer qu’il est possible, pour le coach, d’être toujours présent, d’avoir sans cesse cette qualité de présence, est évidemment illusoire. S’imposer cela, en faire une condition sine qua non du coaching, serait un manque cruel de modestie, un aveuglement irréaliste.
Il en va de même dans la vie de tous les jours : parfois, je suis toutes antennes dehors, réceptive à l’autre, capable d’épauler mes proches, mon mari, mes enfants, mes amis, de les écouter de l’intérieur, de les accueillir. Parfois, j’en suis incapable. En tant que coach, je suis également aux prises avec mes troubles intérieurs, mes contrariétés, grandes ou petites. Bien sûr, je pourrai convoquer la conscience acquise pendant mon parcours de développement personnel pour tenter de faire la part des choses, prendre du recul, démêler mes propres émotions de celles de mon client ou de ma cliente.
Mais il n’empêche : on ne peut accueillir l’autre que dans la mesure où l’on s’accueille soi-même. Et il arrive que s’accueillir soi-même, ce ne soit pas de la petite bière…
Il arrive que l’on préfère laisser ses émotions au vestiaire, de feindre de ne pas les voir.
Il arrive qu’en tant qu’executive coach, on feigne même de ne pas en ressentir, tant le mot « émotions » reste largement banni de la sphère professionnelle et du vocabulaire de l’homo economicus. On demande du rendement : ce que l’on vit à l’intérieur n’est pas important.
Impensable, évidemment, d’imaginer pouvoir être présent à l’autre si on ne l’est pas à soi, et si on entre dans le scénario « No emotions » de l’entreprise…
Cela dit, les émotions, cela peut être vachement encombrant. Prenons l’état dans lequel j’errais au lendemain des attentats de Bruxelles. Colère, tristesse, peur, sentiment de grande fragilité, d’impuissance totale, de trahison, de dégoût, pitié pour tous ces gens qui, en Irak, en Syrie, un peu partout dans le monde, vivent ce genre de drames tous les jours : tout cela m’habitait entièrement.
Que faire, alors, pour accueillir ses émotions, se mettre à l’écoute de son état intérieur, sans pour autant s’en laisser submerger ?
A chacun sa méthode. La mienne, c’est la musique baroque, dont je me laisse pénétrer. La littérature, qui me reconnecte à mes émotions. Et surtout, surtout, le tai chi taoiste http://www.taoist.org/be/: bien plus qu’une « gymnastique douce », il s’agit d’une sagesse qui m’apaise, m’enracine, m’élève, tout en me faisant bouger au plus profond.
Qu’importe la méthode, pourvu que l’on ne se quitte pas, que l’on reste en connexion avec soi-même, présent à ce qui nous habite et nous anime. Pourvu que l’on tombe les armes, que l’on arrête de se battre avec nos démons intérieurs et ceux qui s’affairent à l’extérieur.
Car, au plus l’on se bat avec quelque chose ou contre quelque chose, au plus on lui donne du pouvoir…