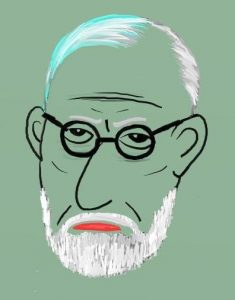par Isabelle Philippon | 18 Avr 2017 | Coaching, Management
Le coaching en entreprise ne serait-il qu’une manipulation pour rendre les salariés plus « utiles », mieux adaptés à un système basé sur la performance économique et le pouvoir hiérarchique ? Cette question nous taraude, à Explicite. Dans notre pratique, nous tentons une voie incertaine et difficile : un coaching éthique.
A l’instar du cocher (les mots « coach » et « cocher » ont les mêmes racines) qui exhorte ses chevaux à aller plus vite, le coach en entreprise est souvent perçu comme celui qui va booster les performances des salariés, en particulier des managers, afin de les rendre conformes aux attentes de l’entreprise. Le coaching en entreprise ne serait rien d’autre, alors, qu’une violence qui ne dit pas son nom : une violence prétendument exercée au bénéfice du coaché, de son mieux-être qui – comme c’est merveilleux – rencontrerait les aspirations aux « résultats » de l’entreprise ou de l’association.
Le coaching en entreprise : pour asservir …
C’est ce que ses détracteurs lui reprochent: le coaching en entreprise est souvent utilisé comme un « airbag affectif » pour des individus de plus en plus sous pression et vulnérables (1). L’intervention du coach en entreprise permettrait de faire coïncider les aspirations personnelles des individus, leur besoin de se sentir mieux dans leur peau au travail, d’être davantage reconnus et valorisés, avec les exigences productivistes des entreprises. Le coaching effacerait alors la frontière entre les aspirations personnelles et les intérêts de l’entreprise ». Il asservirait davantage encore le travailleur, tout en lui donnant l’illusion de s’épanouir.
A Explicite, dans notre pratique d’executive coach, nous avons, effectivement, été confrontés à ce genre de situation. Zoom sur quelques demandes de commanditaires, c’est-à-dire les Ressources Humaines de diverses entreprises, ou la direction elle-même.
1/ « Cela fait un moment que les résultats de ce manager ne progresse plus : vous pourriez le coacher pour stimuler sa motivation et sa combattivité ? »
2/ « Nous ne savons plus que faire de cette employée. Elle sabote systématiquement les décisions de la direction, elle met un mauvais esprit. Nous avons décidé de lui proposer un coaching comme dernière tentative. Si cela ne marche pas, nous serons obligés de la licencier. »
3/ « Je n’en peux plus de la pression inhérente à ce poste de direction. J’ai peur de craquer. Pourriez-vous me redonner l’énergie suffisante pour tenir le coup ? M’aider à gérer mieux mon temps et mon stress ? »
Ces exemples sont tirés de la réalité. Le coach qui tenterait de satisfaire ces demandes « telles quelles » accepterait de s’inscrire dans un processus d’adaptation aux exigences de l’organisation. Pire : il favoriserait, chez le coach en entreprise, l’intériorisation du pouvoir organisationnel.
… ou libérer ?
Voici encore des situations vécues, par les coachés eux-mêmes, cette fois:
1/ « Vous m’avez aidé à prendre conscience que je n’étais plus en phase avec les valeurs de mon entreprise. C’est là où le bât blesse. Il faut que je me mette en quête d’un autre travail. »
2/ « J’ai réalisé à quel point mes principes un peu rigides m’empêchaient d’éprouver de l’empathie pour mon chef et, en règle plus générale, pour quiconque ne partage pas ma vision du monde. Je voyais le monde en noir et blanc, aujourd’hui je distingue les nuances. Cela a des répercussions sur ma vie professionnelle – je m’y sens mieux, plus ouvert, moins sur la défensive -, et aussi sur ma vie privée. »
3/ « Vous avez réveillé ma capacité au lâcher prise, vous m’avez fait prendre conscience de mes besoins et permis de retrouver les mots justes pour les exprimer. Vous ne m’avez pas appris à « gérer mon temps », mais à le prendre. Vous ne m’avez pas appris à « gérer mon stress », mais à le déposer, à solliciter de l’aide, à déléguer. »

Nous ne sommes pas dupes : le coaching participe bien d’un processus de régulation sociale.
Là où la demande apparaît comme asservissante, le résultat semble au contraire émancipateur. Dans la première situation, la personne coachée a décidé de se mettre en quête d’un travail qui lui correspond davantage. Plusieurs mois après la fin de ce travail, il nous est revenu qu’Antoine, ainsi que nous l’appellerons, est toujours dans son entreprise. Mais il se dit apaisé depuis qu’il a pris sa décision. Hier, il craignait les entretiens d’évaluation. Aujourd’hui, il les attend avec sérénité. « Au pire, dit-il, je suis viré. Cela me permettra de chercher à l’aise un autre job, en ayant un peu d’argent devant moi. »
Dans le deuxième cas, on peut certes parler d’une meilleure « adaptation » du sujet avec le monde qui l’entoure. Ce coaching aura donc abouti, c’est vrai, à une sorte de normalisation. Mais cette normalisation n’est, à notre avis, rien d’autre qu’une conséquence du mieux-être de la personne. Majda (prénom d’emprunt), comme elle le dit elle-même, a « changé de branche ». Ce changement de position lui a permis de rejoindre son chef et, plus largement, « l’autre » en général, sur sa branche à lui, et d’appréhender ainsi le monde vu depuis cette situation-là. Majda a accepté que l’autre ne soit pas elle, ne pense pas comme elle, ne vive pas comme elle, n’ait pas les mêmes aspirations qu’elle, et que cela n’en fait pas pour autant un ennemi. Au bout de ce cheminement personnel, elle a acquis, dit-elle, une « fabuleuse liberté ».
Dans la troisième situation, c’est le directeur de l’entreprise (en l’occurrence ici, une association du secteur non-marchand), qui nous avait demandé de l’aider à répondre de façon plus performante à ce qu’il croyait être les exigences de sa fonction. Ses prises de conscience l’ont amené à lâcher prise, à baisser les exigences qu’il s’imposait à lui-même.
Le coaching éthique
Chez Explicite, nous ne sommes pas dupes : le coaching participe bien d’un processus de régulation sociale. Nous ne prétendons pas transformer nos coachés en révolutionnaires, ni les amener à rompre avec les « chaînes » de leur statut de travailleur, à rompre avec leur entreprise, avec la société capitaliste, avec le pouvoir pyramidal. Parfois, ils rompront, changeront de boulot, voire de vie. Mais ce n’est pas le but en soi du coaching. Le but premier du coaching est bien de « réguler ». Mais nous sommes persuadés que ce processus de régulation peut s’opérer sous la forme d’une harmonisation, d’une médiation, plutôt que d’un contrôle ou d’un asservissement (2).
Tant mieux si les chemins d’évolution inventés par les travailleurs rencontrent leurs besoins personnels.
En tant que coachs en entreprise, nous savons que les jeux de pouvoir font partie intégrante des organisations. A ce titre, le coaching peut être positif. C’est le contexte général de l’entreprise, la conception du pouvoir qui y domine et l’intention de la pratique du coaching qui détermineront les outils mis en oeuvre et le sens du coaching. Cela suppose, évidemment, que le coach soit bien conscient des enjeux et des paradoxes inhérents à la situation de coach en entreprise. L’économiste Christian Arnsperger prône une « éthique post-capitaliste », qui ferait passer les entreprises de l’incitation par la réussite matérielle et économique à des « institutions centrées sur l’humanisation existentielle ». « Il s’agit, ajoute-t-il, d’engendrer un désir éthique et une capacité à l’acceptation critique d’une réalité économique au sein de laquelle l’être aura à se créer une voie de libération » (3).
De la même manière, la démarche du coaching peut créer, au sein même des organisations, un espace d’analyse critique des mécanismes, demandes et exigences imposées aux employées et aux cadres, pour leur permettre d’inventer les chemins d’évolution qui rencontreront leurs besoins personnels.
- Gori R. & Le Coz P., Le coaching : main basse sur le marché de la souffrance psychique, in Cliniques méditéranéennes, n°75, 2007.
- Ce qui précède est largement inspiré du travail de fin de formation présenté par Jean-Paul Minet pour l’obtention du Certificat universitaire en Executive Master en Business Coaching, UCL-ICHEC 2009-2010, téléchargeable ici.
- Arnsperger C., Ethique de l’existence post-capitaliste, Paris, Ed. du Cerf,

par Isabelle Philippon | 28 Mar 2017 | Coaching, Développement personnel
La « présence » est un ingrédient essentiel au coaching. Elle est aussi un élément indispensable dans la vie de tous les jours, pour vivre, partager, entrer en relation, aller à la rencontre de l’autre, en profondeur. Dans ce monde qui tourne fou, elle permet aussi de dépasser les traumatismes et de ne pas perdre la tête.
Pour les coachs professionnels, la Présence représente le Graal. Sans une présence intense du coach, pas de coaching réellement puissant. C’est là, sans doute, l’ingrédient indispensable: bien plus que tous les outils (tirés de l’Analyse Transactionnelle, de la Programmation neuro-linguistique, des théories managériales, etc.), qui sont certes très utiles, mais totalement insatisfaisants s’ils ne sont pas soutenus par une présence « transcendante » du coach.
Et cette présence, elle est souvent mise à mal par le désir (légitime) de performance du coach.
Oui, le désir de performance est l’ennemi numéro Un de la présence. J’en sais personnellement quelque chose : jeune (en expérience, pas en âge 😉 ) coach, je me cramponnais à mes outils comme un naufragé à sa bouée. Je voulais donner à mon coaché le meilleur de moi-même, lui faire profiter des outils les plus indiqués, bref, je voulais être efficace, pour le bien de mon/ma client/e. Cela ne fonctionnait pas trop mal, mes clients se disaient pour la plupart satisfaits, et repartaient avec des pistes d’action.
Et puis, un jour, la catastrophe se produisit. Un imprévu dans mon emploi du temps m’avait empêchée de préparer minutieusement une séance de coaching en entreprise. Ce jour-là, je me suis rendue à mon rendez-vous en me reprochant mon impardonnable amateurisme, ma distraction fatale. Ce jour-là, je savais que je ne serais pas parfaite. Et cela me traumatisait. Evelyne (prénom d’emprunt), cadre dans cette entreprise, en souffrance, en stress, méritait mieux que mon impréparation.
Et puis ce jour-là, le miracle se produisit.
Lâcher prise pour aller à la rencontre de l’Autre
J’avais accepté, à ce moment, que mon coaching ne serait peut-être pas « efficace ». Je n’avais pas d’attente de performance. Je n’étais pas dans la volonté de bien faire. J’avais, heureusement, suffisamment de sécurité intérieure pour accepter cette situation. Je me disais que « ce coaching ne serait sans doute pas le meilleur de ma carrière, mais qu’importe, il y aura d’autres séances ».
Et le miracle se produisit.

En acceptant de marcher dans l’obscurité, j’ai pu laisser émerger l’Autre dans toute son intensité. En abandonnant mon ego, paradoxalement, j’ai été réellement, profondément, entièrement, présente à l’Autre dans sa vérité. En n’ayant aucune volonté, j’ai pu laisser être ce qui était là, à ce moment, pour l’Autre.
Je me suis mise à la disposition de l’Autre, sans m’imposer dans le champ. Et là, j’ai fait connaissance avec mon intuition, avec mon essentiel, avec ma justesse. Je me suis autorisée à prendre des risques. Mes paroles ont été puissantes. Je me suis sentie inspirante, élégante. Je me suis sentie géante, avec la finesse d’une fée.
Nous avons, ma coachée et moi-même, célébré cette séance d’une grande intensité.
Curieusement, je me sentais énergisée. Beaucoup moins fatiguée qu’à l’issue de mes autres séances de coaching savamment préparées.
Je n’avais (presque) rien fait et, en ne faisant rien, en laissant Evelyne découvrir à tâtons ses propres ressources, je lui avais permis de trouver son chemin.
J’étais consciente, dès cet instant, que ma pratique du coaching ne serait plus jamais la même. Jusque-là, j’étais une poule aux oeufs d’or pour les écoles de coaching: j’écumais toutes les formations, je n’en avais jamais assez. A partir de ce moment-là, je me suis montrée beaucoup plus parcimonieuse…
J’avais innové en me contentant d’être à l’écoute de l’Autre et de moi-même. Et innover, comme le dit si justement Michel-Ange, c’est simplement libérer la main du marbre qui la tenait prisonnière ».

Etre présent à soi pour garder le cap
Imaginer qu’il est possible, pour le coach, d’être toujours présent, d’avoir sans cesse cette qualité de présence, est évidemment illusoire. S’imposer cela, en faire une condition sine qua non du coaching, serait un manque cruel de modestie, un aveuglement irréaliste.
Il en va de même dans la vie de tous les jours : parfois, je suis toutes antennes dehors, réceptive à l’autre, capable d’épauler mes proches, mon mari, mes enfants, mes amis, de les écouter de l’intérieur, de les accueillir. Parfois, j’en suis incapable. En tant que coach, je suis également aux prises avec mes troubles intérieurs, mes contrariétés, grandes ou petites. Bien sûr, je pourrai convoquer la conscience acquise pendant mon parcours de développement personnel pour tenter de faire la part des choses, prendre du recul, démêler mes propres émotions de celles de mon client ou de ma cliente.
Mais il n’empêche : on ne peut accueillir l’autre que dans la mesure où l’on s’accueille soi-même. Et il arrive que s’accueillir soi-même, ce ne soit pas de la petite bière…
Il arrive que l’on préfère laisser ses émotions au vestiaire, de feindre de ne pas les voir.
Il arrive qu’en tant qu’executive coach, on feigne même de ne pas en ressentir, tant le mot « émotions » reste largement banni de la sphère professionnelle et du vocabulaire de l’homo economicus. On demande du rendement : ce que l’on vit à l’intérieur n’est pas important.
Impensable, évidemment, d’imaginer pouvoir être présent à l’autre si on ne l’est pas à soi, et si on entre dans le scénario « No emotions » de l’entreprise…
Cela dit, les émotions, cela peut être vachement encombrant. Prenons l’état dans lequel j’errais au lendemain des attentats de Bruxelles. Colère, tristesse, peur, sentiment de grande fragilité, d’impuissance totale, de trahison, de dégoût, pitié pour tous ces gens qui, en Irak, en Syrie, un peu partout dans le monde, vivent ce genre de drames tous les jours : tout cela m’habitait entièrement.
Que faire, alors, pour accueillir ses émotions, se mettre à l’écoute de son état intérieur, sans pour autant s’en laisser submerger ?
A chacun sa méthode. La mienne, c’est la musique baroque, dont je me laisse pénétrer. La littérature, qui me reconnecte à mes émotions. Et surtout, surtout, le tai chi taoiste http://www.taoist.org/be/: bien plus qu’une « gymnastique douce », il s’agit d’une sagesse qui m’apaise, m’enracine, m’élève, tout en me faisant bouger au plus profond.
Qu’importe la méthode, pourvu que l’on ne se quitte pas, que l’on reste en connexion avec soi-même, présent à ce qui nous habite et nous anime. Pourvu que l’on tombe les armes, que l’on arrête de se battre avec nos démons intérieurs et ceux qui s’affairent à l’extérieur.
Car, au plus l’on se bat avec quelque chose ou contre quelque chose, au plus on lui donne du pouvoir…

par Isabelle Philippon | 7 Fév 2017 | Coaching, Feed-back, Gestion d'équipe
Un bon chef doit être capable de donner un feedback puissant et authentique, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir saluer les côtés positifs de ses salariés, et aussi leur exprimer ses attentes et exprimer une éventuelle demande. Pleins feux sur le DESC, un outil particulièrement puissant.
Une des pires des situations pour un travailleur: remplir ses taches, jour après jour, et n’en avoir aucun retour, rien, nada. Vous arrivez le matin, vous vous mettez au boulot, vous rentrez chez vous le soir, sans que jamais votre manager, votre chef d’équipe ou n’importe quel de vos supérieurs ne vous fasse la moindre commentaire sur votre travail. Le bore-out, cette maladie dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, est une maladie de l’ennui. L’ennui au boulot, la répétition de gestes sans sens, sans objectif, sans stimulation, sans possibilité de progression, sans relation à l’autre, à ses collègues ou ses supérieurs.
Une des pires situations pour un travailleur : remplir ses tâches et n’en avoir aucun retour.
Sans en arriver à cette situation extrême, certains chefs n’osent pas donner du feedback. Ils ne le conçoivent que nécessairement négatif et, parce qu’ils n’ont pas envie de blesser leurs salariés, ils préfèrent s’abstenir. Ils taisent ce qui ne va pas, de peur de pourrir l’ambiance ou de ne plus être aimés. Ils prennent de plus en plus sur eux, deviennent des candidats tout désignés au burn-out, cette maladie qui brûle les ressources, épuise l’organisme et l’âme. Ces chefs-là sont souvent de belles personnes, humainement parlant, mais de mauvais chefs.
Et puis, il y a ceux – les plus méchants, les plus frustrés aussi, sans doute – qui semblent jouir lorsqu’ils engueulent leur monde, lorsqu’ils démontrent par A + B tout ce qui ne va pas, lorsqu’ils mettent le doigt sur la faille de leurs collaborateurs.
Trois types de personnes très différents, aux intentions diverses. Mais trois mauvais leaders, qui menacent durablement la motivation de leurs équipes.
Indispensables signes de reconnaissance
Les travailleurs ont, en effet, besoin qu’on leur fasse un retour sur leur travail. Certains plus que d’autres. Ceux qui ont besoin d’une reconnaissance extérieure souffrent davantage que ceux qui sont très autonomes, indépendants, et qui ont une bonne opinion d’eux-mêmes. Dans ma carrière de journaliste, j’ai connu un collègue qui menaçait régulièrement de quitter le journal car il attendait vainement que le rédacteur en chef commente par le menu chacun de ses articles. D’autres, en revanche, plus sûrs d’eux, interprétaient l’absence de réaction comme une bonne nouvelle: « Si on ne me dit rien, c’est que c’était bien. » Mais quoi qu’il en soit, à un moment ou l’autre, tout salarié a besoin de savoir si son travail satisfait sa direction. Mieux vaut un feed-back négatif que rien du tout. Mieux vaut des reproches que l’indifférence. Du moins jusqu’à un certain point.
Le feedback positif: essentiel
Rien ne vaut un feed-back positif. Dire à son collaborateur: « Je suis heureux de ton boulot, ce que tu as fait là est particulièrement intéressant, je te félicite », est particulièrement stimulant. Encourager ses équipes, les tenir au courant des chiffres lorsqu’ils sont bons, des projets qui progressent ou aboutissent, des changements encourageants: rien de tel pour instaurer une ambiance de travail épanouissante, conviviale et où chacun donnera le meilleur de soi-même.
Ce n’est qu’en développant nos points forts que nous deviendront vraiment bons.

Ces feedback là, on les oublie souvent. C’est qu’on n’y pas culturellement habitués. Souvenez-vous de l’époque où vous étiez enfant. Vous rameniez votre bulletin à la maison. Sur quoi insistaient vos parents? Sur les mauvaises cotes. Les bonnes étaient considérées comme « normales »; les mauvaises comme inquiétantes, voire inacceptables. Bref, on est conditionnés comme cela. Nous sommes plus doués pour voir ce qui ne va pas, chez soi comme chez les autres, que ce qui va bien. Dommage, car ce n’est qu’en développant nos points forts que nous deviendrons vraiment bons; pas en essayant vaille que vaille de corriger nos points faibles. Et ainsi en va-t-il de nos équipes. Et si vous tentiez d’inverser la vapeur? Et si on s’essayait à féliciter plus qu’à réprimander?
Le feedback correctif: indispensable
Mais la vie d’un chef d’équipe n’est évidemment pas faite que de bonnes nouvelles, et son entourage n’est pas composé que de salariés efficaces et capables de prendre les bonnes initiatives en toutes circonstances. Il arrive que quelqu’un commette une erreur, ait une attitude incompatible avec le bon fonctionnement de l’équipe, ou change de comportement sans qu’on en connaisse la raison. Dans ce cas, un feedback correctif s’impose. Ne rien faire, ne rien dire, c’est prendre le risque que la situation s’envenime, que les relations au sein de l’équipe se dégradent, que les frustrations s’accumulent et que, finalement, les objectifs ne soient pas atteints.
Le DESC: utile dans tous les cas
D’accord, me direz-vous, mais comment faire? Comment s’y prendre? Se mettre en colère, vous l’avez déjà éprouvé, cela soulage parfois, mais ça ne dure pas et cela s’avère rarement efficace sur la durée. Passer un savon, exiger, donner des ordres, menacer, bof. C’est l’artillerie des « petits chefs ». De ceux qui manquent de leadership, c’est-à-dire de charisme et d’autorité naturelle.
Avez-vous déjà essayé le DESC?
D pour Décrire les faits, la situation, de la manière la plus objective possible. Evitez les généralisations telles que celle-ci « Tu arrives TOUJOURS en retard! ». Préférez: lundi, mardi et mercredi, tu es arrivé vingt minutes en retard. Et la semaine passée, c’était pareil. Du coup, le rapport que tu t’étais engagé à remettre pour hier n’est pas terminé. Je ne l’aurai pas à temps pour cette importante réunion de demain. » Cela, c’est du concret, du tangible, de l’observable.
E pour Emotion. Quoi?! Parler de ses émotions en entreprise, vous n’y pensez pas! Eh bien si, on y pense. Là, on parle pour soi. On parle en « Je ». Pas de « Tu qui tue ». Mais: « Je t’avoue que je me sens en colère. Si je t’avais parlé hier, je me serais probablement emporté, j’ai donc préféré attendre un jour avant de te parler. Je suis aussi très inconfortable à l’idée de ne pas pouvoir me baser sur ce rapport pour préparer ma réunion. Et puis, cette situation m’inquiète: que se passe-t-il?
Le feedback impose aussi de laissez la parole à l’autre
Vous venez de franchir les deux premiers pas les plus importants. Maintenant, vous allez laisser à l’autre, votre interlocuteur, l’occasion de s’exprimer, lui aussi. Lui permettre de décrire sa situation, ses émotions.
- « C’est mon gosse/ma femme/mon mari: il/elle est malade, je ne sais plus où donner de la tête, j’ai l’impression de perdre pied. » Ou bien: « Je ne m’en sors pas avec ce rapport, j’ai cru que j’allais y arriver mais au fur et à mesure que les jours passaient, je me suis rendu compte que je n’y arriverais pas. Alors j’ai perdu courage, et j’avais peur de me lever le matin ». Etc, etc.
Il se peut aussi que votre collaborateur se mure dans le silence, qu’il n’ait pas l’envie de vous livrer sa situation. Soit, il faut l’accepter.
Les deux dernières étapes
Reste à présent à mener à bien les deux dernières étapes: le S et le C du DESC.
S pour Solutions. Quelles solutions sont envisageables pour sortir de la situation problématique? Quelles sont les différentes options qui se présentent, au travailleur et au chef? Qu’est-ce qu’on peut mettre en place pour remédier au problème?
Vous serez généralement surpris: quand les deux premières étapes du DESC se déroulent dans le respect du cadre et de l’autre, l’étape « S » se déroule en général très facilement, et les personnes en présence se montrent souvent très créatives et de bonne volonté.
C pour Conséquences. Quelles peuvent être les conséquences éventuelles de ce que l’on vient de décider de mettre en place? Y a-t-il des risques que cela ne fonctionne pas, des obstacles que l’on devrait anticiper? Et si cela fonctionne, quelles seront les conséquences? Aurai-je ce rapport à temps pour cette réunion-ci, ou l’aurai-je à temps lors de la prochaine occasion?
Et, si finalement les actions décidées ne se réalisaient pas? Si le collègue auquel votre collaborateur était censé demander de l’aide ne répondait pas favorablement à la demande? Si le collaborateur ne tenait pas parole ou s’empêtrait davantage dans sa situation compliquée? Que se passerait-il alors? Y aurait-il des sanctions éventuelles? Un point noir dans le dossier d’évaluation? Un rappel à l’ordre écrit?
Ne rien faire, ne rien dire, c’est prendre le risque que la situation s’envenime.
Il arrive que l’étape « C » ne soit pas indiquée. A vous de juger. Tout est fonction du contexte, de la culture de l’entreprise, de la situation précise.
Pas de doute: le DESC est un outil puissant. Mais qui ne s’improvise pas. Il faut le préparer soigneusement. Au début, ce processus vous paraîtra peut-être un brin artificiel. Mais avec la pratique, il vous deviendra naturel. Et vous aurez renforcé votre leadership.

par Isabelle Philippon | 24 Jan 2017 | Coaching, Développement personnel
Tous les coachs qui sont passés par une école de coaching « reconnue » ont entendu ce mantra : « Le coaching n’est pas une psychothérapie, et le coach n’est pas un thérapeute ». Mais tous les coachs qui font le métier de coach le savent bien : la frontière entre coaching et psychothérapie est beaucoup plus ténue et artificielle qu’il y paraît.
J’ai besoin d’un coaching car je ne vois plus clair du tout dans mes projets professionnels. J’aimerais que vous m’aidiez à mettre de l’ordre dans mes idées, à dégager mes priorités.
Cette demande, je l’ai entendue à de multiples reprises depuis que j’ai embrassé le métier de coach. Et j’y ai répondu un même nombre de fois. A première vue, voilà une demande claire: le contrat de coaching sera respecté à la lettre. La déontologie du coach ne sera pas prise en défaut. Il ne s’égarera pas dans les méandres du passé de son client ou de sa cliente, il ne sera pas confronté aux manifestations de l’inconscient.
Foutaises, bien entendu. Si le coach est présent à son coaché, s’il entend ce qui n’est pas dit, s’il voit ce qui bouge sous la surface, sous la peau, dans le coeur, s’il pressent les émotions, s’il en ressent lui-même, l’inconscient ne cessera de se manifester, dans des mouvements de transfert et de contre-transfert qui agiteront le coaché et le coach.
Si le coach est présent à son coaché, il entendra, sous le présent embrouillé, le passé qui s’agite pour sortir de sa tombe. Parfois, souvent même, c’est le coaché lui-même qui s’en ira visiter spontanément son passé, enhardi par l’une ou l’autre question puissante et quelques prises de conscience: surpris par certaines récurrences, curieux d’en savoir plus, avide d’établir des liens, il voyagera entre l’ici et maintenant, et le hier toujours présent.
Si le coach est présent à son coaché, il entendra, sous le présent embrouillé, le passé qui s’agite pour sortir de sa tombe.
Très sincèrement, je me vois mal interrompre ces voyages initiatiques en opposant un « Stop, là nous sortons du cadre du coaching ! ». D’expérience, je sais que ce voyage-là, qui ouvre sur l’imprévisible, l’oublié, le refoulé, est le plus fabuleux qui soit. C’est lui, le plus souvent, qui permet les avancées les plus spectaculaires dans le processus du coaching.
Mais pour « soutenir » ce voyage, pour y accompagner utilement le coaché, c’est bien aux outils acquis durant ma formation à la psychothérapie, et à tout ce que j’ai engrangé durant ma propre psychanalyse, que j’ai recours. Sans eux, je me sentirais bien démunie.
Le coaching n’est pas une psychothérapie…
Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit: je n’ai pas dit que le coaching était une thérapie. Cette relation d’accompagnement n’a pas un objectif thérapeutique, et ce même si, le plus souvent, elle a des vertus « collatérales » thérapeutiques. Ce qui distingue le coaching des psychothérapies?
- Il s’adresse en principe à des personnalités non pathologiques;
- Il est d’une durée convenue à l’avance (ou à peu près);
- Il se focalise (en principe) sur des problématiques liées à la vie professionnelle;
- Il s’intéresse au comment (futur, solutions) et pas au pourquoi (passé, causes).
Tout cela est clair, sur un plan théorique du moins. Le hic : les « personnalités pathologiques » n’ont en général pas l’étiquette « personnalité pathologique » collée sur le front. Certaines pathologies sont discrètes, se confondent presque parfaitement avec une bonne petite névrose « ordinaire ».
…mais le coach devrait être formé à l’approche psychothérapeutique
Qui pourrait reprocher à un coach, même très compétent, de ne pas avoir repéré la psychose qui se cachait sous l’apparence de normalité de son client ou de sa cliente ? S’il n’a jamais été confronté à ce genre de cas, s’il n’a pas dû se farcir une « bible » de psychopathologie au cours de sa formation, s’il n’a pas dû faire un stage au sein d’un établissement accueillant des patients atteints de psychose, border line ou dépressifs, s’il n’a jamais participé à groupes de partage de pratiques, s’il n’a pas évolué sous la férule d’un psychiatre ou d’un psychologue clinicien pour faire ses armes, comment diable pourrait-il être sûr de ne pas s’embarquer dans une aventure qui pourrait s’avérer fort nuisible pour son client ? Comment espérer qu’il réagisse de manière adéquate si son client ou sa cliente « décompense » en pleine séance de coaching un peu trop « remuante » ?
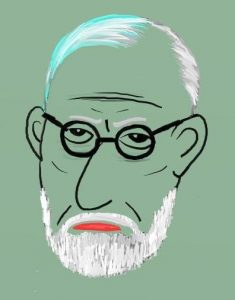
Et, même si l’on sort de ces situations extrêmes, comment fera le coach pour repérer les résistances du coaché, les manifestations de transfert et de contre-transfert, s’il n’a pas été formé à ces notions, ingrédients pourtant essentiels à un accompagnement professionnel de la personne ? Pour démêler les émotions et les pensées que provoquent en lui les dires de son client, comment fera-t-il s’il n’a pas entrepris un long et exigeant travail sur soi, travail inhérent à la pratique de la psychothérapie, et que l’on n’aborde que très superficiellement et très rapidement dans les écoles de coaching ?
Si le coach n’est pas formé aux notions de transfert et de contre-transfert, comment fera-t-il pour en repérer les manifestations chez le coaché?
« Le coaching se focalise sur la vie professionnelle »: cette affirmation fait sourire n’importe quel coach un peu aguerri. L’être humain n’est pas constitué de strates parfaitement indépendantes, le privé d’une part ; le professionnel, de l’autre. Les deux s’entremêlent, dansent et virevoltent dans un mouvement comparable à celui qui unit le présent et le passé. Quant au fait de s’intéresser exclusivement au comment (et donc au futur,) et non pas au passé (et donc aux causes de la répétition d’éventuels échecs ou difficultés), ce serait comme d’administrer un médicament à chaque fois que quelqu’un s’enrhume, sans se préoccuper de savoir s’il vit dans un lieu à l’abri des courants d’air…
J’aurais donc tendance à partager l’opinion de S. Berglas, psychiatre et chercheur à l’école de management de l’UCLA (1). Il s’insurge contre les pratiques « bricolées » des coachs qui ne possèdent pas une formation psychosociale solide, et qui vendent des solutions simples pour des résultats rapides, en ignorant les éventuels problèmes ou enjeux psychologiques sous-jacents. Selon lui, l’expertise psychologique est un pré-requis absolu au métier de coach…
(1) Berglas S., The very real dangers of executive coaching, in Harvard Business Review, juin 2002.